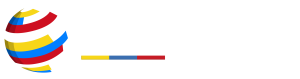Le ministère sud-africain des Transports a confirmé ce départ, indiquant que l’opération avait été menée discrètement en raison de la nature sensible et controversée du programme.
Le groupe est constitué de 11 familles et de plusieurs individus seuls. Il s’agit en majorité de couples d’âge moyen accompagnés de jeunes enfants, mais aussi de quelques personnes âgées. Tous sont de langue maternelle afrikaans et s’identifient comme afrikaners.
D’après les ONG américaines impliquées dans leur réinstallation, la plupart vivaient auparavant dans des régions rurales du Gauteng, du Mpumalanga et de l’État-Libre, et affirment avoir été confrontés à l’insécurité, à la criminalité violente et à une forme d’exclusion économique.
Certains membres du groupe avaient déjà tenté d’émigrer via des visas économiques ou des programmes d’investisseurs, mais se sont finalement tournés vers la voie humanitaire après avoir été déboutés.
« Ce n’est pas une question de privilège, mais de sécurité et de survie », a déclaré Johan du Plessis, un mécanicien de 42 ans originaire de Bloemfontein, parti avec sa femme et ses deux enfants. « Nous ne fuyons pas la guerre, mais des politiques qui ferment lentement les portes à l’avenir de nos enfants. »
Les candidats à la réinstallation ont cité plusieurs raisons :
-
Les politiques de discrimination positive (affirmative action) qu’ils estiment limiter leurs opportunités professionnelles et éducatives ;
-
Les projets de réforme agraire, et en particulier la crainte de l’expropriation sans compensation ;
-
Les niveaux élevés de criminalité dans les zones rurales, notamment les attaques contre les fermiers blancs ;
-
Un sentiment de marginalisation politique et culturelle, avec peu de représentation perçue au niveau national.
Certains ont également exprimé un malaise grandissant face à ce qu’ils considèrent comme une hostilité à leur encontre dans les médias et la sphère publique.
À leur arrivée aux États-Unis, le groupe est accueilli dans deux centres de traitement au Texas et dans l’Idaho, deux États où des communautés conservatrices et chrétiennes ont exprimé leur soutien aux Afrikaners.
Ils bénéficient de programmes privés de parrainage humanitaire, coordonnés par des organisations comme American Families First et Safe Haven Ministries. Ces programmes assurent le logement, l’aide à l’emploi, l’apprentissage de l’anglais et l’intégration culturelle.
Chaque famille a été soumise à un contrôle sécuritaire approfondi et a dû fournir des preuves d’une « crainte crédible » de persécution en Afrique du Sud.
« Ce sont des familles qui se sentent oubliées — marginalisées dans leur propre pays. Nous ne sommes pas là pour débattre de la politique sud-africaine. Nous sommes là pour leur offrir un avenir », a déclaré Rachel Moore, directrice du programme chez American Families First.
Le gouvernement sud-africain rejette fermement l’idée selon laquelle les Afrikaners seraient victimes de persécution raciale, affirmant que les politiques de transformation sont légales et nécessaires pour réparer les injustices de l’apartheid.
« Présenter l’émigration afrikaner comme une fuite humanitaire est une lecture erronée et dangereuse de notre histoire et de nos politiques de réconciliation », a déclaré un porte-parole du ministère sud-africain des Relations internationales.
Aux États-Unis également, des organisations de défense des droits humains critiquent ce programme, l’accusant de biais racial et de détourner l’attention des véritables crises humanitaires affectant d’autres régions du monde.
Bien que ce premier groupe reste modeste, certains observateurs estiment qu’il pourrait ouvrir la voie à une émigration plus large. Des élus conservateurs américains militent déjà pour étendre les quotas d’accueil de « communautés minoritaires menacées d’extinction culturelle », avec les Afrikaners spécifiquement mentionnés.
En Afrique du Sud, la société civile reste partagée : certains y voient un choix individuel légitime dans un monde globalisé, tandis que d’autres dénoncent une tentative de réécriture de l’histoire, inversant les rôles entre anciens privilégiés et prétendus persécutés.
Qu’elle reste marginale ou devienne un phénomène plus large, cette réinstallation relance le débat sur l’identité, la mémoire et l’équité dans l’Afrique du Sud d’aujourd’hui — et soulève des questions plus larges sur la manière dont le monde traite les demandes de refuge à travers le prisme de la race et de la politique.










































![4ème édition du tournoi de Karaté à Goma: le décor est planté pour accueillir la compétition [ Organisateurs]](https://kivuavenir.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241105-WA0030-360x180.jpg)