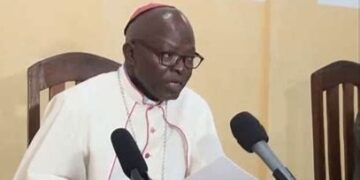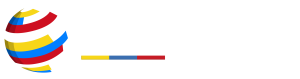Un hommage qui, s’il est bienvenu sur le plan symbolique, tranche nettement avec la situation préoccupante de la liberté de la presse en République démocratique du Congo.
Sur le terrain, les journalistes congolais continuent d’exercer leur métier dans des conditions particulièrement difficiles. Entre censure, menaces, arrestations arbitraires, pressions politiques et violences physiques, la liberté d’informer est loin d’être garantie. Dans son rapport annuel publié à l’occasion du 3 mai, l’ONG Journaliste en Danger (JED) a recensé plus de 120 atteintes à la liberté de la presse en 2024, dont des agressions, des suspensions de médias et plusieurs cas de détention illégale.
Parmi les cas les plus marquants, celui de Stanis Bujakera, correspondant de Jeune Afrique et directeur adjoint du site Actualité.cd, arrêté en septembre 2023 et détenu pendant plusieurs mois, malgré une mobilisation nationale et internationale. Sa situation a illustré les risques réels que courent les journalistes, même ceux basés dans la capitale.
Dans les provinces de l’Est notamment le Nord-Kivu, l’Ituri et le Sud-Kivu les journalistes paient un tribut encore plus lourd. Dans ces régions déchirées par les conflits armés, les reporters sont souvent pris pour cible par des groupes armés, ou accusés d’être partisans par les autorités. Certains sont contraints à l’exil, d’autres travaillent sous anonymat pour éviter les représailles. En janvier 2025, un journaliste de la radio communautaire de Beni a été retrouvé mort après avoir reçu des menaces liées à une enquête sur les groupes armés.
Depuis son arrivée au pouvoir en 2019, Félix Tshisekedi a multiplié les déclarations en faveur de la liberté de la presse. Il a promis à plusieurs reprises des réformes pour décriminaliser les délits de presse et garantir l’indépendance des médias. Cependant, ces promesses tardent à se concrétiser. Le code pénal congolais contient toujours des dispositions permettant d’emprisonner des journalistes pour diffamation ou offense au chef de l’État. De plus, la régulation des médias reste floue et souvent utilisée à des fins de contrôle politique.
Face à cette réalité, les organisations de la société civile, les syndicats de journalistes et les ONG internationales appellent à des actions concrètes : adoption d’une loi sur l’accès à l’information, création d’un mécanisme de protection des journalistes, et surtout, poursuites judiciaires effectives contre les auteurs de violences commises à leur encontre.
La RDC a gagné quelques places dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters Sans Frontières (RSF), mais demeure dans la zone rouge, avec des conditions de travail toujours jugées « difficiles » pour les journalistes. La Journée mondiale de la liberté de la presse est donc, pour beaucoup, moins une célébration qu’un rappel amer des combats qu’il reste à mener.
L’hommage du président Tshisekedi, bien que symboliquement important, ne suffira pas à rassurer les professionnels des médias tant que les engagements politiques ne se traduiront pas par des mesures concrètes et durables. Dans un pays où l’accès à l’information est un enjeu de gouvernance, la liberté de la presse n’est pas un luxe, mais une nécessité.